| . |
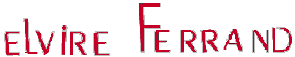 |
ACCUEIL en SCÈNE en IMAGES |
|
|
sur des bases de données extérieures. |
 |
||||
|
||||
 |
|
Pourquoi certaines pièces vous atteignent-elles plus que d’autres ? Va savoir…je crois que c’est lorsque c’est l’intime qui est touché, et que l’on ne peut rien dire d’autre que : « C’est beau ». Je crois aussi que c’est lorsque le sens poétique du langage se met à ressembler à de la musique. C’est manifestement - pour moi, bien sûr - le cas avec « J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne », l’une des dernières pièces de Jean Luc Lagarce que met en scène Frédéric de Goldfiem au TNN jusqu’à la semaine prochaine. Rappelons la thématique de la pièce (…) :5 femmes ont attendu le retour du fils, du frère, chassé il y a des années par le père, mort depuis. Elles n’ont pu empêcher son départ, aucune ne sais ce qu’il est advenu de lui. Quand s’ouvre la pièce, il vient juste d’arriver, épuisé, revenu de tout. Elles l’ont transporté dans sa chambre d’enfant, à laquelle nulle d’entre elles n’a touché. Peut être est-il déjà mort ? Toute la pièce est comme un oratorio où ces cinq voix, se croisent, se répondent, partent dans de longs mouvements, chacune avec sa propre énergie. C’est un perpetuum mobile qui s’arrête parfois en suspens. Elles s’écoutent chacune de façon très attentive. La forme du mouvement qu’impulse leur dialogue est circulaire, sur le fond et sur la forme. Sur le fond parce que tout « tourne » autour du fils-frère revenu, sur la forme par la langue de Lagarce, où l’on retrouve le cheminement d’une pensée au plus près de l’intime en train de s’exprimer. Allez, filons la métaphore : il me semble entendre un quintette à cordes : deux violoncelles, deux violons, un alto. Et j’ai comme l’impression que chacun des rôles de « J’étais dans ma maison… » s’empare à un moment d’un instrument différent. Et à cette formation de chambre, il y aurait comme un conducteur invisible, ce serait ici le fils-frère pour achever on ne sait quoi, peut-être sa vie, en tous cas un cycle. Frédéric de Goldfiem choisit de nous le montrer sur scène, ce conducteur : dans un coin de la scène, sur un lit, présence un peu lointaine, cette chambre où rien n’a bougé depuis son départ, comme ces cinq femmes qui depuis ont comme été en suspens, et ne savent pas trop si elles ont retrouvé le réel : et lui aussi, il y est sans y être, même si de temps à autre des rôles (« la plus vieille », peut être une domestique, « la mère ») vont le visiter, replacer ses draps, le réconforter, tout cela peut-être en vain. Ces action renforcent cette ténuité, cette évanescence. Et ce qui me passionne avec la mise en scène de Frédéric de Goldfiem, c’est qu’elle se dit : « Comment entrer dans le concret de ce long poème ? Comment trouver des équivalences matérielles aux fulgurances qu’envoie le texte ? » C’est-à-dire comment passer du dit lyrique, fluide, à la matérialité d’un fait ? Les « disantes » sont définies par des lignes de vies, elles sont sur scène comportementalisées, leurs rapports au réel sont induits par le poème et dirigées par les situations. Ce ne sont pas des personnages au sens où la dramaturgie « quotidienne » les entends, mais des figures, des arcanes : « la plus vieille », « la mère », « l’ainée », « la seconde », « la plus jeune ». Plus l’arcane majeur, « lui ». Les cinq comédiennes ont trouvé des temps justes, un équilibre entre le mouvement et son absence : on écoute le poème dit par des êtres de chair. Nous sommes dans le domaine du subtil équilibre, qu’éclaire la finesse des lumières d’Alexandre Toscani. Dans les costumes simples, d’une beauté évidente, de Stéphanie Marin se meuvent Irène Chauve, Catherine Duflot, Elvire Ferrand, Cécile Mathieu, Elodie Ségui. Lui, c’est Mustapha Elmanferrah. Jacques BARBARIN Paru au numéro de juin 2004 de la revue PCA |